| |
|
|
| |
|
|
| |
Les nouveaux
choix des femmes |
|
Baisse
spectaculaire de la fécondité. Plus instruites,
plus indépendantes, les Maghrébines ont désormais
d'autres priorités que de fonder une famille nombreuse
Les
femmes du Maghréb font de moins en moins de bébés.
Au point qu'aujourd'hui elles ont pratiquement rejoint le niveau
européen. "Le Maghréb est passé, en
trente ans, de 7,5 à un peu plus de 2 enfants par femme,
ce qui représente une évolution au moins aussi rapide
que la Chine", souligne Jacques Vallin, directeur de recherche
à l'Institut national d'études démographiques
(Ined) et coauteur, avec Zahia Ouadah-Bedidi, d'une étude
publiée en juillet dernier dans la revue de l'institut,
Population et sociétés . Le Maghréb n'a mis
en réalité que trois petites décennies pour
parcourir le même chemin que la France en deux siècles.
En Tunisie - le premier des trois pays à avoir amorcé
le virage - la fécondité n'était plus que
de 2,2 enfants par femme en 1998, soit pratiquement au seuil de
remplacement. Au Maroc en 1996 et en Algérie en 1997, elle
était de 3,1. En supposant que le mouvement se soit poursuivi
au même rythme, la Tunisie devrait, pour l'an 2000, être
à 2 enfants par femme, l'Algérie à 2,3 et
le Maroc à 2,5. Avec, dans ce dernier pays, une très
grande différence entre les citadines, dont la fécondité
rejoint celle de la Tunisie, et les femmes de la campagne, qui
ont encore un peu plus de 4 enfants en moyenne.
Le recul de l'âge du mariage
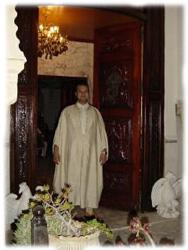 |
Comment
en est-on arrivé là, et si vite?
Le
recul de l'âge du mariage apparaît comme un
phénomène majeur", soulignent les chercheurs
de l'Ined. Un changement de comportement d'autant plus déterminant
qu'il s'agit de sociétés où la procréation
n'est pas concevable hors mariage.
En
Tunisie, l'âge du mariage des femmes est passé
de 19 ans en 1956 à 27,8 ans aujourd'hui; au Maroc,
de 16 ans en 1960 à 26 ans en 1995; en Algérie,
de 18 ans en 1966 à 27,6 ans en 1998. "En Tunisie,
ajoute Zahia Ouadah-Bedidi, plus de la moitié des
femmes de 25 à 29 ans ne sont pas mariées,
et on approche de ce taux dans les deux autres pays."
Il s'agit là, probablement, de l'une des mutations
socioculturelles les plus importantes de ces dernières
années. |
Widad
vient de terminer sa médecine. A 25 ans, cette jeune Algérienne
issue d'un milieu modeste ne compte pas s'arrêter en si
bon chemin. "Maintenant, dit-elle, je vais m'inscrire en
gynécologie. Et mon fiancé, qui a terminé
lui aussi cette année, en ophtalmologie." Pas question
de se marier avant d'avoir terminé ses études. "Le
mari, ajoute-t-elle, pourra toujours partir un jour, mais mes
diplômes et mon travail, personne ne pourra me les enlever.
C'est ça qui m'aidera dans la vie, en cas de coup dur."
Le fiancé acquiesce...
A
33 ans, Souad, elle, n'a pas fait le choix du célibat.
Comptable dans une entreprise publique algérienne, elle
avait opté pour un cursus universitaire beaucoup moins
long, afin d'avoir le plus vite possible une activité salariée.
"Jusqu'à récemment, dit-elle, je ne pensais
pas du tout au mariage. J'ai commencé à y penser
lorsque j'ai rencontré mon fiancé, il y a deux ans.
Mais nous n'avons pas de logement et il n'est pas question pour
nous d'habiter avec sa famille ou la mienne." Donc ils attendent
que la Caisse d'épargne, qui fait également de la
promotion immobilière et où ils ont déposé
une demande, leur fournisse un appartement. "Nous ne sommes
pas exigeants: le plus petit sera le bienvenu pourvu que nous
soyons seuls."
Une exigence nouvelle de qualité de vie
Le
recul de l'âge du mariage est très directement lié
à l'amélioration du niveau d'instruction des femmes.
Pour Aziz Ajbilou, professeur à l'Institut national de
statistique et d'économie appliquée (Insea), à
Rabat, c'est même un facteur essentiel, car l'instruction
modifie les aspirations des femmes. Elles souhaitent alors, souvent,
exercer une profession, leur conception du couple et de la famille
change. Le rapport de l'Ined souligne ainsi qu'en Algérie,
en 1992, les femmes ayant atteint le niveau secondaire se mariaient
environ sept ans plus tard que les analphabètes. Plus instruites
et plus indépendantes, les femmes veulent un "bon
mariage", et surtout choisir leur conjoint. Quitte à
retarder l'union.
 |
Ce
n'est pas un hasard si c'est en Tunisie que la fécondité
a d'abord baissé. C'est en effet le pays qui a, le
premier, choisi de conduire une politique volontariste en
faveur de la scolarisation des femmes, de leur accès
à l'emploi et de l'amélioration de leur statut
dans la société. Tout en opérant, parallèlement,
une mutation du droit de la famille grâce à
l'adoption, dès 1956, du Code du statut personnel
(voir l'article ).
Même
si le droit n'y a pas évolué de la même
manière, l'Algérie et le Maroc ont suivi le
mouvement. L'Algérie de Houari Boumediene a généralisé
la scolarisation. Les progrès ont été
plus lents au Maroc, où plus qu'ailleurs les différences
demeurent grandes entre les villes et les zones rurales.
Dans
les trois pays, les femmes sont aujourd'hui nombreuses à
avoir une activité professionnelle, pas toujours
d'ailleurs par ce qu'elles l'ont souhaité, mais souvent
pour des raisons économiques. |
| Outre
l'accès à l'instruction et les changements
de mentalité qu'il induit, d'autres facteurs moins
positifs expliquent que les Maghrébines - et les
Maghrébins - se marient de plus en plus tard: la
montée du chômage des jeunes (26% pour les
25-34 ans au Maroc, pour un chômage global de 17%,
selon les statistiques nationales) et la crise du logement.
La
pénurie d'appartements pour les jeunes couples,
particulièrement aiguë en Algérie,
est également une réalité au Maroc,
où le taux d'urbanisation est très important.
|
|
Mariées
plus tard, les femmes sont en outre de plus en plus nombreuses
à utiliser un moyen contraceptif. "Si
le retard du mariage a été, dans les trois pays,
le facteur premier de la baisse de la fécondité,
soulignent les chercheurs de l'Ined, il n'aurait évidemment
pas suffi à faire tomber celle-ci aux niveaux très
bas auxquels elle est parvenue aujourd'hui sans une maîtrise
de la fécondité dans le mariage."
La contraception
ne cesse d'augmenter
| La
contraception n'est pas interdite par la religion islamique,
de ce point de vue plus ouverte que la catholique. Le azel
- coït interrompu - est mentionné dans le Coran
comme une pratique licite. Mais il est vrai que le discours
des imams est, lui, plutôt conservateur. Il a donc
fallu, là aussi, que les choses bougent. Et, une
fois encore, les Tunisiennes ont été les pionnières.
Certes,
le Maroc et la Tunisie mettent officiellement en place la
même année, en 1966, une politique de planning
familial. Mais, au Maroc, elle n'existera pendant longtemps
que sur le papier, alors qu'en Tunisie l'impulsion donnée
par les autorités politiques débouche sur
un véritable programme national de limitation des
naissances.
Le
développement de la contraception ne commencera en
réalité qu'un peu plus tard au Maroc, grâce
à l'activisme des associations féminines.
L'Algérie des années 70 est opposée
à une politique visant à réduire les
naissances, et les Algériennes sont, au contraire,
invitées à faire des enfants.
Un
thème commun à la Chine et à l'Algérie
lors de la conférence des pays non alignés
de 1974. Toutefois, même alors, il est possible de
se procurer la pilule ou de se faire poser un stérilet
dans les centres de la Protection maternelle et infantile.
Dans les années 80, le discours officiel évolue.
On parle non plus d'"investissement démographique",
mais de "programme de contrôle de l'accroissement
démographique". |
Aujourd'hui,
selon les deux chercheurs de l'Ined, la contraception
aurait déjà réduit de près
de moitié la fécondité dans le mariage
et la population de femmes maghrébines utilisant
un moyen contraceptif ne cesse d'augmenter. En Tunisie,
elle est passée de 5% à la fin des années
60 à 60% en 1995. En Algérie, elle était
également de 57% en 1995, et 62% aujourd'hui, au
lieu de 8% en 1970.
Au
Maroc, désormais, 59% des femmes mariées
utilisent un moyen contraceptif, alors qu'elles n'étaient
que 5% à la fin des années 60. Ouvrière
à Casablanca, Amina a 26 ans. Elle vit dans une
seule pièce avec son mari mécanicien et
le jeune couple n'a pas encore d'enfants. "Personne
ne comprend que je ne sois toujours pas enceinte après
trois ans de mariage. Dans ma famille, ils pensent même
que je suis stérile. Mais, moi, je ne veux pas
d'enfants avant d'avoir de quoi les nourrir et les éduquer.
Et je n'en aurai pas plus de un ou deux. Les enfants aujourd'hui
coûtent cher. Je ne veux pas que les miens soient
dans la rue."
|
 |
Par
ce que la Tunisie a commencé plus tôt, et
que le réseau de centres du planning familial a
joué un rôle important, le stérilet
occupe encore la première place (42%), devant la
stérilisation (21%), tandis que l'avortement -
1 pour 9 naissances - n'est pas rare. C'est, en revanche,
la pilule qui domine très largement en Algérie
(79%) et au Maroc (67%). "Curieusement, souligne
Rachida Benkhelil, directrice de la population au ministère
algérien de la Santé et de la Population,
la pression religieuse de ces dernières années
dans notre pays n'a pas eu d'impact sur la contraception.
En
1970, l'argument religieux intervenait dans 10% des cas
de refus d'utilisation des moyens contraceptifs, et il
est aujourd'hui de 5%." Au Maroc, les autorités
mettent depuis quelques années l'accent sur le
développement du planning familial dans les zones
rurales ou dans les bidonvilles, où des campagnes
de sensibilisation sont régulièrement organisées.
"Quatre enfants, c'est déjà trop. On
n'arrive pas à joindre les deux bouts. Alors, ici,
au dispensaire, on me donne de quoi ne pas en avoir d'autres",
dit Ghalia. A 30 ans, cette jeune femme qui vit dans un
bidonville de Salé, près de Rabat, a déjà
quatre enfants de 11 ans à 18 mois.
|
Ghalia est analphabète. Mais, dans la plupart des cas,
le niveau d'instruction est déterminant. "La multiplication
des services de planning familial ne suffit pas à garantir
la chute de la fécondité dans le mariage: encore
faut-il qu'émerge réellement chez les couples le
désir de limiter leur descendance. Et cela ne se produit
qu'avec le changement économique, social et surtout culturel",
soulignent les chercheurs de l'Ined. De plus en plus de femmes
de niveau universitaire raisonnent comme Aïcha. Cette jeune
Marocaine de 29 ans occupe un emploi de cadre dans une banque
et n'est toujours pas mariée. "Il faut savoir trouver
un équilibre entre sa carrière et sa vie de famille,
dit-elle. Une fois mariée, j'attendrai sans doute un bon
moment avant d'avoir des enfants. J'en ai envie, mais je veux
aussi pouvoir vivre ma vie de couple."
De plus en plus de jeunes femmes choisissent, comme elle, de limiter
le nombre de naissances non seulement pour mieux élever
leurs enfants, mais aussi au nom d'une exigence, nouvelle, de
qualité de vie. Malika a 45 ans. Elle gère à
Alger un grand restaurant "qui marche bien". Elle a
pourtant choisi de n'avoir que deux enfants, aujourd'hui âgés
de 20 et 17 ans. "Si je me suis arrêtée à
deux, dit-elle, c'est d'abord pour avoir une certaine qualité
de vie. Il fallait leur consacrer beaucoup de temps et d'énergie.
J'avais peur, en en ayant d'autres, de ne pas être à
la hauteur. Pour leur éducation, certes, mais surtout pour
l'affection. Je crois que ma mère était dépassée
par ses sept gosses. Je ne voulais pas refaire la même chose
et que mes enfants me le reprochent un jour." Sa hantise
d'avoir plus de deux enfants l'a même amenée à
recourir à trois reprises à l'avortement à
la suite d' "accidents" de stérilet. Le mari
de Nacera est cadre dans une entreprise publique et gagne bien
sa vie. Le couple, pourtant, n'a que trois enfants, une fille
de 13 ans et deux garçons de 10 et 6 ans. "Le troisième,
dit Nacera, c'était un accident. Je voulais m'arrêter
à deux, mon mari aussi. Nous ne voulions pas d'une famille
nombreuse. Maintenant, je peux voyager. Chaque été,
et parfois même en hiver, je peux partir avec mon mari et
mes enfants passer quelques jours à l'étranger.
Mais, si j'avais plus d'enfants, le pourrais-je? Je ne pense pas.
D'abord, économiquement, ce serait plus difficile, mais
pratiquement, aussi, ce serait plus compliqué. Alors c'est
bien comme ça." Ouarda, elle, a carrément décidé
depuis fort longtemps qu'elle n'aurait qu'un seul enfant. C'est
la condition qu'elle a posée à son mari avant leur
mariage. Elle se destinait à faire du journalisme, donc,
forcément, elle savait qu'elle manquerait de temps. "Trop
de déplacements. Et puis, franchement, avoue-t-elle, je
n'ai pas la patience d'élever plusieurs enfants."
|